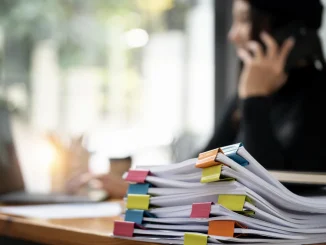Éco-blanchiment : La justice s’attaque aux fausses promesses vertes
Face à la montée en puissance du greenwashing, les autorités durcissent le ton. Décryptage des nouvelles règles qui encadrent les pratiques trompeuses en matière environnementale. L’émergence d’un cadre juridique contre l’éco-blanchiment Le greenwashing, ou éco-blanchiment, […]